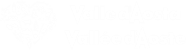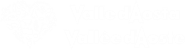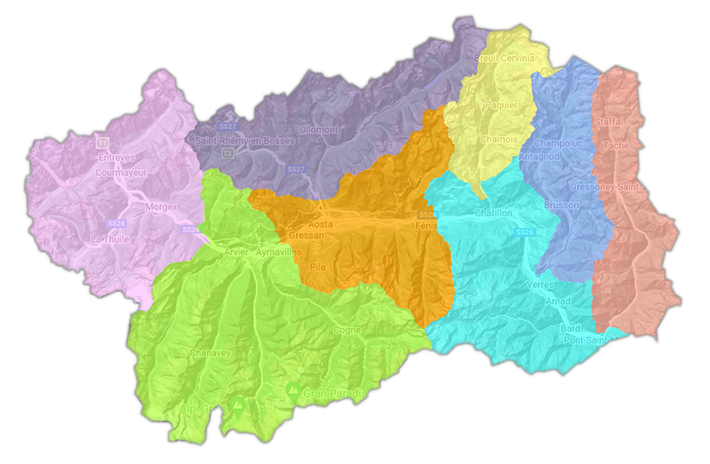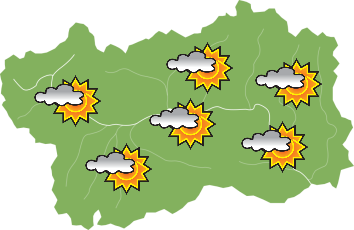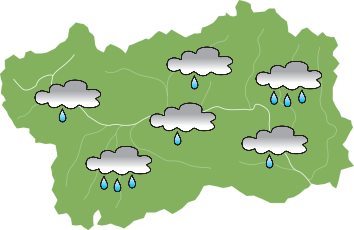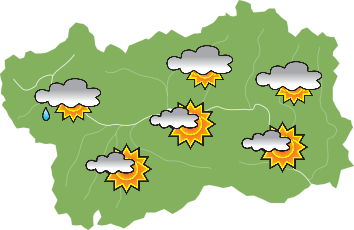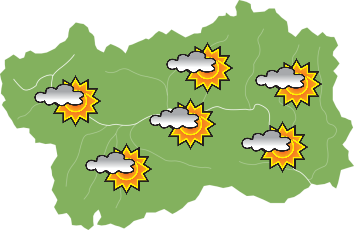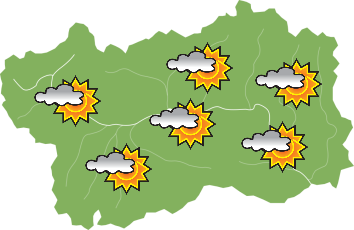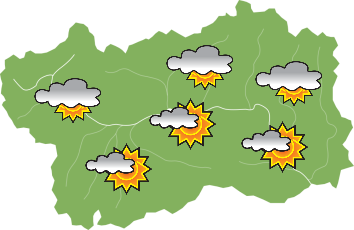Le Château de Châtillon est adossé à l’église paroissiale, au milieu d’un parc splendide.
Il semble dater de l’époque romaine, car le nom de Châtillon lui-même vient de “castrum” (=“château”) et désigne donc une localité qui devait abriter une forteresse romaine.
Après être passé entre les mains de plusieurs familles de la noblesse, à la fin du XIVème siècle, le château passa à la propriété des Vicomtes d’Aoste, ensuite devenus Seigneurs de Challant. En 1400, Jean de Challant soigna son agrandissement. De cette époque, on peut encore voir la salle des archives avec son plafond en bois et ses murs ornés de fresques, ressemblantes à celles du château de Fénis.
En 1435, François de Challant qui n’avait aucun héritier mâle, demanda que l’on fit une exception à la loi salique afin que les Savoie l’autorisent à faire un testament en faveur de ses filles. Catherine devint ainsi héritière, mais les autres membres de la famille pressèrent le Duc de Savoie d’intervenir afin qu’il nomme un nouvel héritier, Jacques de Challant, neveu de Jean, et déclare Catherine et son époux, Pierre d’Introd, rebelles. Ces derniers, décidés à résister, fortifièrent le château d’Introd, mais ils furent obligés de se rendre à l’armée de Jacques qui démolit les murs d’enceinte et endommagea sérieusement le manoir.
De Jacques, le château passa entre les mains de Louis qui le restaura complètement. En 1502, son successeur, Philibert, à l’occasion du baptème de son fils René, fit décorer l’intérieur de la chapelle à l’est avec des peintures que l’on peut toujours admirer. En 1678, Georges de Challant fit décorer l’arche en verre de la chapelle avec l’effigie de la Sindone sacrée pour rappeler la déposition de la précieuse relique lors de son transfert de Chambéry à Turin.
En 1717, Paolina Solaro de Govone, épouse de Georges-François, procéda à la troisième reconstruction du château. En le modifiant et l’agrandissant, il ne modifia pas uniquement son aspect extérieur, mais il améliora aussi son confort. On doit la réalisation de la ruelle des tilleuls et du jardin à la française à Paolina.
En 1755, un tremblement de terre endommagea sérieusement le château et ce n’est qu’en 1769 que Charles-François-Octave a pu commencer la reconstruction du toit et des murs. En 1770, il revint à François-Maurice qui mourut un an après la naissance de son fils unique Jules-Hyacinthe. Ce dernier devint donc l’héritier universel sous la tutelle de sa mère Gabriella Canalis di Cumiana ; dernier descendant des Challant, il mourut le 2 mai 1802, à l’âge de sept ans.
En 1814, après 18 années de veuvage, Gabriella épousa Aimé Passerin d’Entrèves qui, en 1841, après la mort de son épouse, hérita de l’ensemble du patrimoine des Challant.
Ses descendants firent procéder aux travaux suivants : démolition de la tour hexagonale située à l’entrée et le pont-levis, remplacé par le bâtiment du gardien, la serre et les écuries ; construction d’une petite tour ornée de fenêtres pour éclairer le grand escalier conduisant à l’étage supérieur et fermeture du parc par une clôture.
Le château est privé et n’est ouvert au public qu’à l’occasion d’événements particuliers, tandis que le parc peut être visité.